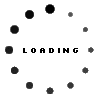A Paris, la Salsa is dead !
-
Comment Paris a tué la salsa ?
En tentant de domestiquer, de styliser le déhanché caraïbe, les Parisiens l’ont tué. C’est en tout cas l’avis de l’écrivain portoricain Héctor Feliciano, qui a mené l’enquête dans les bals latinos de la capitale.
J’apporte de mauvaises nouvelles. Quand on voit Paris s’adonner avec autant d’enthousiasme à la salsa, on se dit que les choses vont très mal. Cela signifie-t-il que cette musique que nous aimons tant – et sur laquelle nous avons tant dansé – est moribonde ? Paris fut la capitale de mouvements artistiques débordant de vitalité tels que l’impressionnisme, le modernisme ou le surréalisme. Mais n’oublions pas qu’elle fut aussi, en des temps de décadence, la capitale du rococo, du jardin à la française tiré au cordeau, de l’intellectualisation et de la codification, transformant la vie à l’état brut en un ensemble policé de lois et de règles méthodiques qu’il fallait impérativement respecter. C’est à Paris que l’on a tenté d’immortaliser l’art des époques passées en inventant le musée moderne, un espace qui arrache de leur contexte naturel des œuvres réalisées des décennies ou des siècles plus tôt et les transporte à des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance, loin de leur histoire, pour les exposer à la vue d’admirateurs n’ayant pas la moindre idée des secrets de leur création. C’est ce qui est arrivé aux peintures religieuses italiennes réalisées pour orner et rehausser tel recoin bien précis d’une église ou d’un palais, aux sculptures égyptiennes destinées à être exposées en plein air, à des masques africains qui, immobiles, muets, prisonniers du temps, séparés de leurs rites et de leur usage quotidien, ne recèlent ni ne distillent plus la même signification.
Et voilà que la même chose arrive à la salsa, transportée sur les berges lointaines de la Seine, où sa connaissance s’est progressivement rationalisée pour devenir un code orthodoxe et absolutiste que l’on enseigne, que l’on apprend, que l’on protège des impuretés. Si la salsa est à la mode à Paris, c’est qu’elle est déjà musée, passé, abstraction.
Dans ce pays merveilleux et contradictoire de Latins qui font sagement la queue, tout acte est cérébral : discuter, faire l’amour, déprimer, se caresser, déguster un plat, critiquer, faire de la politique. Et c’est ainsi que les Français dansent la salsa, comme un processus mental codifié.
A Paris, rien dans la salsa n’est laissé au hasard. Un peu d’ordre, que diable ! Foin de ces mélanges mulâtres, métis, désordonnés, improvisés, sauvages, du déhanchement délicieux, soudain et spontané, caractéristique de sa contrée d’origine. Dans la Ville lumière, la salsa n’a pas grand-chose à voir avec la réalité des bals et des rues des Caraïbes, où l’on s’éclate et l’on se déhanche sans chichis. En France, la salsa s’apprend dans des boîtes et des écoles bien organisées qui aseptisent* et rangent dans des catégories la spontanéité des hanches, des pieds, des épaules.
- Salsa cubaine ou salsa portoricaine ?
Tous les jeudis, vendredis et samedis, des jeunes gens d’origine européenne et propres sur eux se mettent en rang, les unes maquillées, les autres hypersapés, pour appliquer avec exactitude et bonne volonté les leçons apprises durant la semaine. Ils vont à l’élégant Latina Café, sur les Champs-Elysées, à Los Mexicanos, plus démocratique, à La Pachanga ou encore au moins intime Diablito Latino, près de la République. Mais là où la foule est la plus nombreuse et la plus mélangée, c’est aux grandes fêtes salsa organisées sur les quais de Seine (“Salsa sur les quais”), qui réunissent certains soirs, en plein air, plus de 2 000 adeptes des rythmes caraïbes. Les Parisiens vont jusqu’à reproduire, à des milliers de kilomètres de son lieu de naissance, mais de façon ultrastylisée, le conflit larvé qui a opposé les spécialistes aux Caraïbes : cubaine ou portoricaine, la salsa ?
Ce conflit vient de loin, de l’histoire commune aux deux dernières colonies espagnoles d’Amérique jusqu’en 1898 [l’Espagne vaincue par les Etats-Unis perd cette année-là Cuba et Porto Rico]. Depuis, chacune des deux îles continue d’être le reflet inversé de l’autre.
Les célèbres vers de Lola Rodríguez de Tió, poétesse portoricaine et révolutionnaire cubaine, résument parfaitement cette trajectoire commune : “Cuba y Puerto Rico son/de un pájaro las dos alas,/reciben flores o balas/sobre un mismo corazón” [Cuba et Porto Rico sont les deux ailes d’un oiseau, fleurs et balles les atteignent dans le même cœur]. Les habitants des deux îles se ressemblent tant qu’ils se méprisent souvent, comme deux frères qui retrouvent l’un chez l’autre ce qu’ils détestent. La musique cubaine a influencé le monde entier, mais surtout les Portoricains. On ne peut raconter l’histoire musicale de l’une sans parler de l’autre, car elles sont étroitement imbriquées : Daniel Santos, l’un des plus grands chanteurs de la musique cubaine, était portoricain, tout comme Rafael Hernández, le compositeur du morceau emblématique et éminemment cubain El Cumbanchero.
Le reggaeton a détrôné la salsa au royaume de la sensualité.
- Ceux qui dansent à la cubaine* et ceux qui dansent à la portoricaine*
Les antagonismes ont perduré et sont arrivés jusqu’au XXIe siècle par le biais de la danse. Reste que, malgré le même côté joueur, on ne bouge pas le corps de la même façon à Cuba et à Porto Rico. La danse populaire cubaine se divise en deux styles, le casino [en couple, jeu de jambes sobre, passes épurées] et un autre, le plus populaire et le plus répandu, le despelote, plein de sensualité et de charme, mélange de grâce, de rythme et d’allure, que l’on danse les bras en l’air en ondulant frénétiquement des hanches aux épaules. La portoricaine, plus élégante et plus réservée, se décline aussi en deux versions : la danse de salon, en couple, où la femme tombe régulièrement dans les bras de son partenaire, est très répandue à New York ; l’autre, plus populaire, exalte une sensualité contenue (et non explosive) par des mouvements de hanches plus doux et plus discrets, le torse en avant et les épaules en arrière, dans une attitude qui rappelle le flamenco.
Ce dernier avatar tout en subtilité du différend cubano-portoricain, d’ores et déjà théorisé par les commentateurs français, divise les danseurs en deux groupes, ceux qui dansent à la cubaine* et ceux qui dansent à la portoricaine*.
Dans les salles bondées de Paris, les adeptes de la salsa forment ainsi deux groupes. Sur un mode exclusif et discriminatoire, les uns ne dansent pas avec les autres. Avant même le premier pas, la question fatidique fuse : “Tu danses portoricain ou cubain ?”* De fait, le résultat est un mélange d’inventions issues de la très féconde imagination classificatrice française : personne ne danse de cette façon ni à Cuba ni à Porto Rico. La danse pratiquée de nos jours à Cuba est plus improvisée, plus vivante que ces mouvements théoriques qu’effectuent les Français. Et personne ne danse le style portoricain* à Porto Rico. Le plus étonnant, c’est que les Français, tout à leur passion du catalogage et de la domestication, n’ont pas laissé de place à l’apprentissage de cette danse populaire et spontanée qui est celle de la grande majorité des habitants des Caraïbes, de Cuba et de Porto Rico jusqu’au Venezuela, en passant par la Colombie. Dans cette région qui l’a vu naître, la salsa se danse comme on navigue : à vue, au jugé.
En France, les adeptes de la plus grande des Grandes Antilles, les plus nombreux, dansent à la cubaine*, puisque c’est ainsi qu’ils appellent le style casino. Les couples décrivent des cercles successifs, sans jamais se lâcher, et réalisent des figures en arabesques de plus en plus complexes en croisant les bras. Les corps sont très droits et le déhanchement très limité. Les salseros parisiens apprécient beaucoup la rueda cubaine, une version plus complexe du style casino dans laquelle plusieurs couples dansent en cercle et réalisent des figures parfaitement synchronisées. Quand la musique retentit, l’un des danseurs mène et donne le nom d’une figure, du pas à exécuter. A chaque appel, les couples doivent reproduire le pas annoncé. La rueda donne donc naissance à une chorégraphie impressionnante : la danse est un mécanisme parfaitement huilé, sans heurts. Régulièrement, les hommes doivent changer de partenaire, sans pour autant rater le moindre pas.
De leur côté, moins nombreux, les fans de la plus petite des Grandes Antilles, Porto Rico, dansent le long d’une ligne imaginaire qui s’étend devant eux, alternant pas en avant et pas en arrière, en obéissant strictement au rythme de la musique. Le couple change souvent de position à grand renfort de passes, mais peu de croisements des bras. A la portoricaine*, la femme est placée au centre de la danse, pour mettre en valeur ses mouvements face aux autres couples de danseurs et au public. Les passes sont plus amples, mais plus simples aussi ; elles sont souvent très sensuelles et d’inspiration nettement rétro, empruntant au vieux mambo et au swing des années 1940 et 1950. Chaque partenaire peut également danser en solo et improviser de nouveaux pas.
C’est ainsi qu’un soir, au Bistrot latin, au-dessus d’un cinéma d’art et essai de la rue du Temple, je fus contraint de révéler mes origines et de répondre : “Je danse à la portoricaine.”* C’est du moins ce que je croyais jusque-là. Car je venais à peine de débarquer à Paris en provenance de ma petite île tropicale. Après un instant d’hésitation, je me suis lancé dans une bachata sur une superbe salsa de Willie Colón. Sur la piste, les Français m’observaient avec un air extrêmement déconcerté et un profond mépris – avec une distance anthropologique pleine de méfiance. A leur grand étonnement, les Français qui m’entouraient constatèrent que, certes, j’étais bien de là-bas, mais que je ne dansais pas (ou ne savais pas danser) comme les gens de là-bas. “C’est très festif”*, commenta ma partenaire, dédaignant, froide mais polie, la futile badinerie de ma danse. Tous ces inconditionnels de la salsa parisienne n’étaient pas plus enthousiasmés par mon style : ils savent bien, eux, ce que c’est de danser à la portoricaine* ; ce n’est pas la même chose (je le compris à cet instant) que de danser a la puertorriqueña.
- Le style à la cubaine* c’est en réalité du bon vieux rock.
Si l’on se lançait dans une petite généalogie de la salsa en France, on découvrirait une histoire en palimpseste, comme ces manuscrits médiévaux que l’on effaçait pour écrire un nouveau texte qui gardait les traces du précédent. On apprendrait ainsi que, derrière la rigoureuse stylisation d’aujourd’hui, les mouvements des mains et les passes élégantes et très conscientes d’elles-mêmes sont des vestiges du rock, dansé dans toutes les fêtes françaises jusqu’au milieu des années 1990. Ces virevoltes et bras tendus si semblables au style à la cubaine* proviennent en réalité du bon vieux rock. Et cette influence si répandue aujourd’hui en France sert, d’une certaine manière, à compenser une difficulté physique essentielle : celle de mettre en mouvement les hanches et les pieds, seuls ou en rythme, à la caribéenne. Bref, si votre corps ne bouge pas, remuez les bras avec un peu de raffinement, même si cela doit ôter à la danse toute cette sensualité, ce rythme physique profond qui unit les partenaires.
Il faut savoir que la Ville lumière danse sur un répertoire qui laisse peu de place aux morceaux récents. L’essor de la salsa à Paris coïncide de fait avec son temps mort. Car l’univers musical salsero s’est depuis quelque temps peuplé de morts. Outre les sympathiques membres du Buena Vista Social Club, Celia Cruz, Tito Puente, Héctor Lavoe, Pete El Conde Rodríguez, Charlie Palmieri et Marvin Santiago nous ont abandonnés pour rejoindre l’immense salle de bal céleste où les attendaient déjà Cortijo, Ismael Rivera et les nombreux vétérans de la Fania, légendaire maison de disques new-yorkaise. Et le temps passe aussi ici-bas. Rien qu’à Porto Rico, cette île qui a produit plus de salsa au kilomètre carré que nulle part ailleurs, à l’exception bien sûr de Cuba la mélomane, la majorité des maîtres salseros ont dépassé la cinquantaine, voire la soixantaine, si ce n’est plus : Willie Colón, Andy Montañez, Eddie Palmieri, Ray Barreto, mais aussi la plupart des membres du Gran Combo ou de la Sonora Ponceña, et même le chanteur Cheo Feliciano. Le plus jeune s’appelle Gilberto Santa Rosa, et il a déjà plus de 40 ans. A l’étranger aussi, le grand sonero vénézuélien Oscar D’León a dépassé la soixantaine et le Colombien Joe Arroyo la cinquantaine. Mais le pire, c’est que la pérennité du genre semble menacée, car la relève ne se bouscule pas au portillon. La nouvelle génération ne produit que peu de salseros, à quelques rares exceptions près, comme le jeune chanteur portoricain Víctor Manuel.
Une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, c’est bien connu, et aux indices inquiétants relevés à Paris viennent s’en ajouter d’autres. Comme pour Pedro Navaja [nom d’une célèbre chanson de Ruben Blades], la vie réserve des surprises. Tout à la beauté de la danse et de la musique, nous sommes rares, parmi les adeptes de la salsa, à nous être rendu compte que les nouvelles générations de citadins des Caraïbes avaient trouvé un son plus urbain encore et que la salsa ne leur plaisait plus, ne les faisait plus danser.
- le reggaeton a détrôné la salsa.
C’est Porto Rico, non plus New York, qui est aujourd’hui l’épicentre du nouveau phénomène musical. Là-bas, le reggaeton [ou reguetón, mélange de reggae et de hip-hop en espagnol] a détrôné la salsa. Tego Calderón, Héctor El Bambino, Don Omar, Lito y Polaco ou encore Daddy Yankee, telles sont les icônes de la nouvelle génération, qui lui parlent de ce qu’elle comprend, de ce à quoi elle aspire. En ces temps de croissance, le reggaeton se veut ultra-urbain, dur et sensuel, aussi jeune que le fut jadis la salsa, tout aussi visuel qu’elle l’est, mais moins exigeant en ce qui concerne les pas. La vengeance, le mépris, le dépit amoureux, que la salsa sanctionnait en se moquant de la femme ou par une morale, le reggaeton les fait payer en nature, par la domination et la séduction à outrance. A l’aise dans les villes où ils vivent, sans la moindre distance psychologique avec elles, exaltés par leur propre vie et par la consommation, les chanteurs se donnent des airs de caïds impitoyables et sans cœur, inflexibles et bourrus, chantant sur un rythme saccadé des paroles sans appel et lâchant des conseils fielleux sur la vie, le sexe et les conquêtes amoureuses. Cette force, la salsa l’a eue autrefois, mais aujourd’hui elle dépérit, chassée par une musique qui nous paraît plus sévère, moins dansable et moins facétieuse. Que nous réserve l’avenir, à nous les salseros ? Assisterons-nous immobiles à notre déchéance sur la piste de danse ? Seuls et anéantis ? Je ne crois pas. L’envie de danser et de s’amuser est trop forte, et le déhanché traditionnel trop profondément enraciné.
On commence à déceler des signes de ce que l’on espère être un genre. Andy Montañez, Ismael Miranda, Gilberto Santa Rosa et Tego Calderón se sont mis à enregistrer des fusions savoureuses et entraînantes de salsa et de reggaeton. Au début du XXe siècle, une musique urbaine, jeune, solide, syncopée et sensuelle, presque interdite, se forgeait dans les quartiers cubains, portoricains et new-yorkais, avant d’évoluer et de faire son entrée dans les salles de bal et de devenir la salsa que nous dansons encore aujourd’hui. On aimerait bien que le nouveau perreo [s’apparente au doggy style, à forte connotation sexuelle, la femme dansant dos à son partenaire] connaisse le même sort. Entre-temps, profitons-en car la vie est courte et le répertoire de la salsa riche et varié. Et, en attendant qu’un audacieux ose rédiger sa nécrologie, dansons jusqu’au bout de la nuit !
* En français dans le texte.
SOURCE : Courrier International
Vues : 47